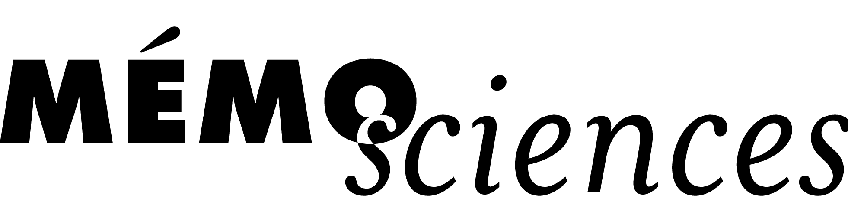
Lavoisier et la Révolution chimique
Mercredi 10 novembre 2004,14h. (Département de Chimie, UCL)
Le Laboratoire de Lavoisier au Musée des Arts et Métiers
Thierry Lalande (CNAM, Paris)
La collection d'instruments de laboratoire d'Antoine-Laurent Lavoisier conservée au Conservatoire National des Arts et Métiers constitue depuis toujours l'un des "clous" de la visite de ce musée. A la disparition du célèbre chimiste, son matériel de laboratoire comptait 13 000 pièces dont seulement 500 sont encore conservées et 100 seulement exposées. Dans cette faible quantité sont néanmoins représentés les appareils les plus prestigieux et les plus novateurs. On peut en effet classer la collection en trois catégories : les instruments classiques du chimiste du XVIIIème siècle (pompes, thermomètres, ballons…), les instruments traditionnels réinventés par Lavoisier (balances par exemple) et enfin les innovations remarquables que sont les gazomètres et les calorimètres.
L'amélioration ou la conception de ces appareils suppose une collaboration étroite entre savant et constructeur qui annonce l'ère de la science expérimentale du XIXème siècle.
Thierry Lalande est Professeur agrégé de sciences physiques, responsable des collections du domaine de l’Instrument scientifique au Musée des arts et métiers, CNAM. Il fut le commissaire de l'exposition La boussole et l'orchidée ; Humboldt et Bonpland 1799-1804 ; Une aventure savante aux Amériques qui retraçait le voyage scientifique de ces deux naturalistes.
Lavoisier et la nature de l’eau
Danielle Fauque (Université de Paris XI)
En 1783, Cavendish découvre que la combustion de l’air inflammable (hydrogène) dans l’air déphlogistiqué (oxygène) conduit à la formation d’une quantité non négligeable d'eau. Il interprète ce résultat dans le cadre de la théorie du phlogistique.
Lavoisier reprend l’expérience et en explique le résultat à l’aide de sa récente théorie de la combustion : l’eau n’est pas un élément, elle est un corps composé. Il donne une démonstration publique de la synthèse de l’eau le 26 juin 1783, puis il réalise la décomposition de l’eau à la fin de l’année. En février 1785, grâce à des instruments conçus spécialement pour cette expérience, il réalise, devant une commission de l’Académie, la synthèse d’une quantité mesurable d’eau puis son analyse. Cette expérience publique très médiatisée préparait l’attaque décisive qu’il porte contre le phlogistique en juin 1785. À partir de ce moment, beaucoup de chimistes se rallièrent à la nouvelle chimie.
L’exposé de cet épisode permettra de mettre en avant la méthode de recherche et les techniques expérimentales du fondateur de la chimie moderne.
Danielle Fauque, docteur en histoire des sciences, travaille sur la chimie du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, et a publié un recueil de textes de Lavoisier, avec introduction et commentaires, destiné aux enseignants et aux étudiants, Lavoisier et la naissance de la chimie moderne, Vuibert, 2003.
D. Fauque enseigne
les sciences physiques au lycée et a animé des stages de formation de
professeurs en histoire des sciences pendant vingt ans.